|
L’histoire - Les
fouilles -
Les publications
Le
musée gallo-romain
-
Le Centre
d’interprétation de
la chaussée romaine
L'histoire
Le village de Waudrez est
aujourd'hui rattaché administrativement
à l'entité communale de Binche.
Situé en
province de Hainaut, il fait partie de
l'arrondissement de Thuin. De ce bourg
rural dépendent les hameaux de Bruille,
Tout-Vent, La Commune, Champ-Perdu,
Mont-de-la-Justice et Waudriselle. D'une
superficie globale de 894 hectares avant
la fusion de communes de 1976, ce
village borde un large tronçon de
l'antique chaussée romaine "Bavay -
Tongres - Cologne"
Dans l'Antiquité, ce
territoire était englobé dans la
province de Gaule Belgique, puis de
Gaule Belgique seconde. Il appartenait à
la Cité des Nerviens, dont le chef-lieu,
Bavay, était distant d'un peu moins de
30 kilomètres. L'agglomération moderne,
dont le centre ne se superpose pas aux
ruines antiques, s'étend le long de la
Bruille, qui délimite à l'Ouest le petit
plateau de la Ville de Binche. Le centre
de l'occupation romaine doit être, quant
à lui, placé aux alentours du point de
confluence de la Samme et de la Bruille,
les deux ruisseaux qui donnent
conjointement naissance à la Princesse,
affluent de la Haine et de l'Escaut.
Le lien de parenté
historique existant entre Waudrez et
l'antique agglomération de
Vodgoriacum fut très tôt décelé et
demeure incontesté.
Ce toponyme antique
nous est parvenu par l'entremise de deux
itinéraires romains : la Table de
Peutinger et l'Itinéraire d'Antonin.
La Table de Peutinger,
ancêtre de la carte routière, mentionne
pour nos régions une route reliant deux
chefs-lieux importants : Bavay et
Cologne. Sur cette dernière, le premier
vicus mentionné en partant de
Bavay ([BAGA
CONER])
est
[VOGO DORGIACO],
situé à XII leugae (soit
environ 28,2 km) de la capitale
nervienne. Mais le nom cité ne paraît
pas fiable. Nous avons sans doute ici
une transcription fautive du copiste de
Colmar (comme pour Bavay, qu'il faut
lire
BAGACO NER(viorum)).
L'itinéraire d'Antonin,
réalisé sous le règne de Caracalla
(188-217) et complété sous Dioclétien
(284-313), plus scrupuleux en ce qui
concerne les toponymes, fait état de
l'existence d'un vicus appelé « VODGORIACUM »parmi
les relais impériaux. Malheureusement,
son auteur mélange
distances en milliers
de pas et en lieues gauloises, et
replace donc l'agglomération à 12 M.P.
(soit 17,8 km) de Bavay.
L'analyse contradictoire des deux
documents permit néanmoins de replacer
Vodgoriacum à Waudrez dès le
XVIIlème siècle.
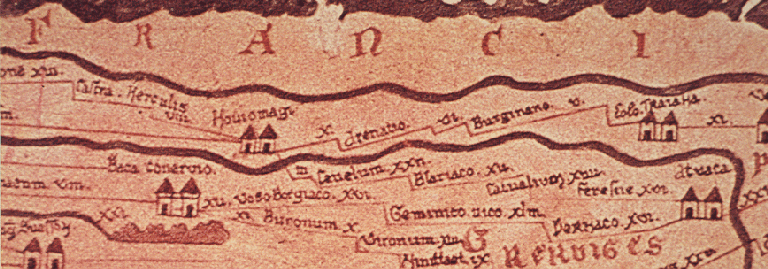
La Table de Peutinger (extrait)
Du point de vue du
peuplement régional, une première vague
importante d'expansion humaine toucha le
Hainaut avec la révolution néolithique.
Le territoire de Waudrez semble avoir
été lui-même concerné par ce mouvement,
comme en attestent une hache de silex
trouvée en 1977 ou
d'autres découvertes
plus anciennes.
Durant l'âge du bronze puis du fer, de
nouvelles populations s'installèrent
dans ces contrées, apportant au passage
les techniques
métallurgiques. Parmi ces
dernières peuvent être mentionnées les
tribus belges et plus particulièrement
les Nerviens qui prirent le site de
Bavay pour place forte. Une origine
celtique hypothétique du nom
Vodgoriacum impliquerait qu'un
village se soit développé dès cette
époque
à cet endroit.
Mais aucune trace matérielle n'en a été
découverte.
Certains historiens
locaux ont tenté de démontrer
l'importance de Waudrez dans la Guerre
des Gaules menée par César de 58 à 51
avant notre ère. Suivant les cas, ils en
ont fait le lieu de rassemblement des
Nerviens avant la bataille du Sabis,
en 57 avant notre ère, ou encore
le lieu
où Quintus Tullius Cicero, frère
du grand orateur et légat de César,
aurait établi son camp et s'y serait
fait assiéger par les Belges en 52
avant
notre ère.
Ici non plus, hélas, aucune découverte
n'est venue étayer ces glorieuses
prétentions villageoises.
Après la conquête de nos
régions par Rome, Bavay demeura
chef-lieu de la Civitas Nerviorum,
entité territoriale et administrative de
la
province de Gallia Belgica.
Sept voies partant de Bavay furent
aménagées sous le règne d'Auguste ou de
Tibère, afin d'améliorer les
communications et donc la sécurité dans
ces territoires extrêmes de
l'Empire.
Une série de
localités, déjà existantes ou crées
ex nihilo connurent alors une
croissance rapide, comme villages-étapes
ou relais.
Parmi ceux-ci figure
Vodgoriacum.

La cité des Nerviens
Etiré tout en longueur,
ce site antique a livré en son cœur près
du passage de la Princesse par la
chaussée antique, plusieurs tessons de
céramique sigillée d'époque augustéenne,
ainsi que des fragments de vases Kurkurn
de tradition indigène. D'autre part,
quelques vestiges d'une nécropole de la
première moitié du ler siècle
de notre ère furent découverts en 1911,
à proximité du site. Ceci démontre que
dès le premier tiers du ler
siècle de notre ère, un vicus,
de taille réduite sans doute, prit
forme.
Les
multiples découvertes archéologiques, qu'elles soient monétaires,
céramiques ou autres, semblent indiquer que l'agglomération connut un
vaste développement à partir de la deuxième moitié du premier siècle de
notre ère, pour atteindre son acmé entre les règnes de Trajan (98-117)
et de Septime Sévère (193-211).
Outre l'abondance des
objets d'importation, témoigne de ceci
une découverte exceptionnelle. A
Péronnes-lez-Binche, soit à peine plus
d'un kilomètre du site, un milliaire (I.L.B.
n°136), sorte de borne kilométrique
antique, fut trouvé, entier, le 25 juin
l979. Conservé au Musée de Mariemont, il
porte l'inscription suivante :
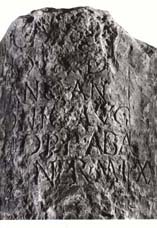
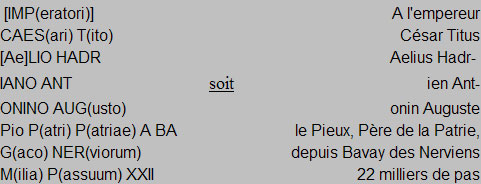
L'inscription du milliaire de
Péronnes-lez-Binche
Enrichi par le commerce,
l'agriculture ou l'exploitation de la
fameuse forêt charbonnière, le vicus
de Vodgoriacum semble avoir subi
les contrecoups directs et indirects des
invasions germaniques des IIème
et IIIème siècles. En effet,
le nombre de monnaies retrouvées à
l'effigie des empereurs du IIIème
siècle est nettement inférieur à celui
du siècle précédent.
Le site connaît en tout
cas une vague de destruction vers
255-260 de notre ère, sous les règnes de
Valérien ler et Gallien, et
est, sans doute, alors largement
abandonné. La réorganisation
administrative des provinces par
Dioclétien, à la fin du IIIème
siècle, qui fit passer le vicus
dans la Provincia Belgica Secunda,
et l'Edit du Maximum, qui visait à fixer
les prix et les salaires, et donc à
endiguer l'inflation galopante, ne
changèrent sans doute pas grand chose à
la vie de l'agglomération.
La réaffectation de la
voie vers une vocation essentiellement
militaire, avec construction de nombreux
fortins de défense, eut certainement
une
incidence importante pour les habitants
de Vodgoriacum. Un site militaire
fut-il érigé à Waudrez ? Aucun vestige
ne confirme actuellement cette
hypothèse. Mais la chose n'est en soi
pas impossible. Les forts militaires les
plus proches sont ceux de Givry à
l'Ouest, et de Morlanwelz à l'Est.
La chute de Cologne,
prise par les Francs en 355, donna
certainement le coup de grâce au vicus.
La plus récente des monnaies découvertes
remonte d'ailleurs à l'empereur Constant
qui régna en 347-348 de notre ère. En
388 une incursion de Francs venus de
Germanie franchit le Rhin et ravagea nos
régions, tuant et pillant au passage.
Enfin, en 406 de notre ère, le pouvoir
romain abandonnait très officiellement
toutes prérogatives sur nos territoires
aux Francs.
Qu'advint-il de l'ancien
vicus de Vodgoriacum ? Nul
ne peut le dire. Il semble en tout cas
acquis que le centre de l'habitat
s'était déjà déplacé sur les rives de la
Bruille, un peu en amont. Le nom s'est
lentement transformé en Walderiego,
qui donnera
Waudrez.
Le territoire de l'ancien
vicus
connut au cours des temps bien des régimes politiques. Après la période
de l'Austrasie franque, il fit partie de l'empire carolingien, puis de
la Lotharingie. A l'époque féodale, il fut le centre administratif de
l'alleu de Binche sous l'autorité des Comtes de Hainaut. En 1433, avec
le rattachement du Hainaut au Duché de Bourgogne, il passe sous
contrôle bourguignon. Puis vint le temps des dominations espagnoles et
autrichiennes. A l'époque de la révolution française et sous le régime
napoléonien, Waudrez fut enfin inclus au département de
Jemappes.
Ainsi a survécu le nom de
l'antique vicus de Vodgoriacum...
Les fouilles
Le site de l'antique
agglomération fait l'objet de recherches
archéologiques sporadiques dès 1838, en
raison de nombreuses découvertes
fortuites lors de labours. Mais aucune
fouille préalable n'est menée avant la
seconde moitié du XXème
siècle.
En 1952, en effet, le
Service National des Fouilles entreprend
les premiers travaux archéologiques
scientifiques. Poursuivis en avril 1953
par Maurice LEFORT, pour la Section de
la Belgique ancienne des Musées Royaux
d’Art et d’Histoire de Bruxelles, dans
une prairie à quelques 1500 m au Sud du
vicus, ceux-ci recoupent un mur
de bâtiment romain, solidement
construit, et situé au Sud de la route
Binche-Mons.
En 1957, Dominique de
GENNARO, de Mons, archéologue amateur
passionné de préhistoire et
d’archéologie, s’intéresse à quelques
trouvailles de surface réalisées par
Paul MAURY de Waudrez sur sa «terre
à légumes» située au Nord-Ouest de la
chaussée. Lors de ses recherches,
essentiellement limitées à cette zone,
il dresse quelques vagues coupes
stratigraphiques ainsi que quelques
notes situant approximativement les
sondages réalisés.
Il met notamment au jour
« une petite cave, située à l'angle
d'une habitation, mesurant 2,30 m sur
1,40 m et d'une profondeur totale de
1,10 m dont 70 cm à parois verticales et
à fond bien plat ». Il baptise celle-ci
«Fosse Gallien», du nom de l'empereur à
l'effigie duquel il y a découvert deux
monnaies.
Après son décès en 1975,
son épouse confie une partie de ses
collections au Musée de Mariemont.
Hélas, les quelques notes très
imprécises et le matériel découvert
incomplet rendent difficile la
réalisation d’une publication.
En 1976, grâce à
l’intervention de Philippe DEKEGEL,
Président fondateur du Cercle
Archéologique de Waudrez, et de son ami
Louis LAURENT, membre de la Société de
Recherches Préhistoriques en Hainaut,
une partie plus importante de
découvertes, le cahier de notes de
Dominique de GENNARO ainsi que le
matériel confié à Mariemont sont enfin
regroupés et confiés au Cercle
Archéologique de Waudrez.
Les découvertes réalisées
par Dominique de GENNARO seront publiées
en 1983 par Philippe DEKEGEL et Claire
MASSART, archéologue, avec le concours
de la Fédération des Archéologues de
Wallonie.
(«Trouvailles anciennes
provenant du vicus de Waudrez »
-collection de GENNARO-
Waudrez - 1983)
Passionné par la période
romaine, Philippe DEKEGEL entreprend
alors un véritable collationnement de
toutes les informations et traces de
découvertes réalisées à Waudrez autour
de la chaussée romaine.
De 1976 à 1978, sa
détermination à regrouper les
trouvailles, à récolter le moindre
indice, son travail de prospection de
surface et de prospection aérienne
permettent enfin de localiser de manière
précise l’emplacement de l’antique
Vodgoriacum.
En 1978, les tranchées
effectuées par le Centre de Recherches
Archéologiques Nationales de
l’Université de Louvain n’ont rencontré
aucune structure en dehors de la route
antique.
De 1978 à 1993, le Cercle
Archéologique de Waudrez (CAW)
entreprit, chaque année, une campagne
de recherches archéologiques sous la
responsabilité scientifique de Philippe
DEKEGEL. Plusieurs bâtiments ainsi qu’un
puits romain exceptionnel sont mis à
jour. Cahiers de fouilles, coupes
stratigraphiques, relevés
topographiques, inventaires précis du
matériel découvert, mise en valeur des
collections apportent enfin au site de
Vodgoriacum toute la valeur qu’il
mérite.
En 1989, le site de
Vodgoriacum fait enfin l’objet d’un
classement.
De fin 1999
à fin 2010, Pierre CAPERS,
licencié en Histoire, Histoire de l’Art
et Archéologie, membre de l'ASBL Statio
Romana, succède à Philippe Dekegel dans
sa fonction de responsable scientifique
de l'association.
En collaboration avec d'autres
scientifiques, il réalise la publication
des fouilles de la nécropole et du puits
romain qui avaient été effectuées par la
STATIO ROMANA.
D’un point de vue
pratique, le site classé de
Vodgoriacum est désormais divisé en
sept zones - ou secteurs de fouilles -
bien distinctes.
Nous présentons la
synthèse des recherches modernes qui
suit en respectant cette division plutôt
que d'une manière strictement
chronologique.
Notons au passage
qu'aucune fouille n'est visible
actuellement.
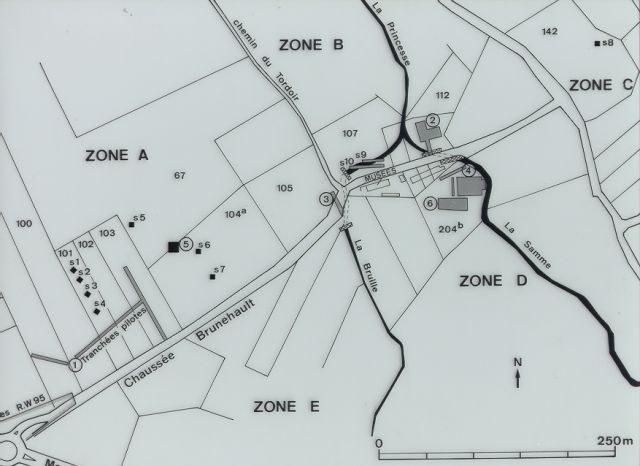
Plan du site
et zones de fouilles
Zone
A
:
Située au Nord de la
chaussée Brunehault, cette zone est
délimitée à l'Ouest par la route Binche
- Mons (N.90) et le chemin de Péronnes
et à l'Est par l'ancien chemin du
Tordoir.
Consacrée aux terres de
culture, il s'agit certainement de l'une
des parties les plus importantes du
vicus, comme en attestent les
résultats des découvertes fortuites
ainsi que les divers sondages.
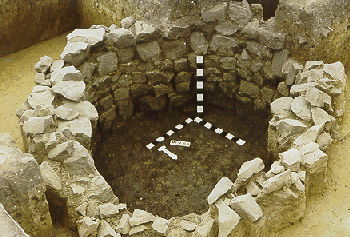
Le puits
Lors de la réalisation
d'une fouille, durant l'été 1983, une
découverte majeure est réalisée dans
cette partie du vicus. Située à
77 m de la chaussée moderne, la fouille,
sous la conduite scientifique de
Philippe DEKEGEL, établira qu’il s’agit
d'un puits de plus de l2 mètres de
profondeur.
Construit en pierres de
grès locales taillées et appareillées
avec soin sans mortier de sable ou de
chaux, ce dernier fut réalisé durant le
premier tiers du Ier siècle.
Son comblement rapide à l'aide de tas de
terre, de poutres calcinées et grosses
pierres, est pour partie de caractère
rituel et devrait être replacée vers le
3ème quart du IIIème
siècle. L'analyse des différents niveaux
de remplissage et du matériel
archéologique très abondant qu'il
contient permet en effet de dresser une
chronologie relativement précise de son
utilisation et de son abandon.
De nombreux squelettes d'animaux furent
également mis au jour dans ce
puits. Le fonds du puits, situé à
13 m sous le sol antique, ne fut atteint
qu'en 1985. L'hypothèse de la présence
d'un grand complexe de bâtiments
ceinturant cette structure, implanté
perpendiculairement à la chaussée
romaine, ne paraît pas à exclure.
(« Vie
Archéologique » - puits et nécropole de
Vodgoriacum, 3 études- Bulletin de la
Fédération des Archéologues de Wallonie
- n°60 - 2003)
Zone
B
:
Sise au Nord de la
chaussée, cette zone est délimitée à
l'Ouest par l'ancien chemin du Tordoir
et à l'Est par la rue de la Princesse.
Elle encadre donc les deux rives de la
rivière qui porte le même nom.
En 1978, un projet de
dérivation du cours de la rivière et de
ses deux affluents, la Samme et la
Bruille, en vue de leur canalisation
conduisit les pas du Cercle
Archéologique de Waudrez dans ce nouveau
secteur du vicus et plus
particulièrement sur la rive droite de
la Princesse.
Les archéologues du CAW
dégagèrent un petit bâtiment
quadrangulaire, de 5 mètres de côtés.
En 1984, la Ville de
Binche entreprend enfin les travaux de
canalisation prévus. La réalisation des
travaux lourds ne touche heureusement
aucune structure archéologique si ce
n'est un tronçon de la chaussée antique.
Zone
C
:
Située à l'Est du vicus,
cette zone encadre de part et d'autre la
chaussée Brunehault et englobe le
Mont-de-la-Justice. Elle est limitée à
l'Ouest par la rue de la Princesse. Son
relief particulier et la présence de
nombreuses bâtisses et propriétés
privées, parmi lesquelles le Château
Desenfan et son parc boisé, ont empêché
toute recherche dans cette zone.
Toutefois, en 1978, le
CRAN effectua un rapide sondage sur les
pentes du Mont-de-la-Justice. Le désir
des archéologues était de retrouver le
point de passage de l'antique chaussée
Brunehault. Ce sondage n'a révélé aucune
structure construite.
Zone
D
:
Placée au Sud de la
chaussée Brunehault, la Bruille
constitue sa limite occidentale. Cette
zone s'étend vers l'Est jusqu'à la rue
de la Princesse, franchissant au passage
le cours de la Samme. Au sud, elle est
bordée par la N.90 Binche-Mons.

Bâtiment avec bain sur hypocauste
En 1979, les recherches
du Cercle Archéologique de Waudrez se
portèrent sur cette nouvelle partie du
vicus. Là aussi, c'est le futur
réaménagement du cours des rivières qui
poussa les archéologues dans leurs
investigations.
Ainsi, sous la
responsabilité scientifique de Philippe
DEKEGEL, un vaste complexe de bâtiments
y fut découvert. A la surprise générale,
apparurent rapidement de vastes
installations balnéaires avec lambeau de
radier d'hypocauste. A l'extérieur des
installations, une trace rougie révélait
encore l'emplacement de l'entrée du
praefurnium.
En 1980, un petit bassin
absidial fut mis au jour. Plusieurs murs
qui s'enchevêtrent prouvent les nombreux
réaménagements de ces bâtisses. Trois
niveaux de construction semblent se
surimposer. Des surfaces de circulation
extérieures, faites d'empierrements,
sont aussi exhumées : il pourrait s'agir
de chemins. Mais la fouille de ce
quartier est abandonnée fin l982, au
profit d'autres secteurs.
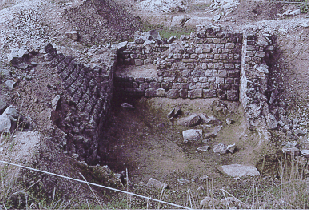
Cave avec soupirail
En 1986, la fouille de la
parcelle 204b, appelée « zone des
bains», reprend enfin. De nouvelles
fouilles permettent le dégagement du
prolongement des murs découverts en
1981. La découverte la plus marquante de
cette année est celle d'un soupirail
d'une cave, desservie par un escalier.
Au fond de la cave fut retrouvé un
vaisselier aux vases de cuisine
emboutis. Couvert d'une tuile, il était
composé de 5 vases de format différent.
Dans le coin Nord de la cave, où l'on
peut remarquer une assise de réglage en
tuiles, une enseigne de fer fut
retrouvée au côté de tuiles.

Dès 1990, la suppression
des banquettes permit d'avoir une vue
d'ensemble des bâtiments. S'étendant au
Nord, la fouille mit au jour d'anciennes
structures comblées de grosses pierres.
Une paroi de terre crue ou de torchis
fut découverte dans un sol en place. En
outre, une fosse à charbon de bois
apparut sous un sol empierré. De forme
parfaitement circulaire, elle ne put
être que partiellement vidée. Cette
dernière livra de nombreux tessons de
céramique grise et de scories de fer.
Passablement altérés par les
intempéries, les structures furent
finalement rebouchées en 1994, deux ans
après l'arrêt du chantier.
Zone
E
:
Cette zone de forme
triangulaire est comprise entre la
chaussée Brunehault au Nord, la Bruille
à l'Est et la route Binche-Mons (N.90)
au Sud-Ouest. Elle inclut le rond-point
de Vodgoriacum.
Exception faite des
maisons et des hangars commerciaux
construits en bordure de la N.90, elle
est exclusivement composée de prairies.
Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune
fouille moderne par le CAW, mais des
vestiges y ont été découverts.
Profitons néanmoins de
l'occasion pour mentionner les fouilles
menées en 1995 par les Services
Archéologiques de la Région wallonne
dans le cadre du réaménagement du
rond-point en question par le Ministère
de l'Equipement et des Transports.
Plusieurs états différents de la
chaussée furent découverts de même que
quelques tombes à incinération, un four
de potier et quelques édicules de forme
quadrangulaire, aux murs maçonnés.
Zone
F
:
Longeant la chaussée
Brunehault, dont elle occupe le flanc
méridional, cette zone s'étend jusqu'aux
limites de la commune d'Estinnes à
l'Ouest. Sa limite orientale est
constituée par le rond-point de
Vodgoriacum.
Aucune fouille récente
n'a été pratiquée dans cette partie du
site, mais la présence de vestiges
d'époque romaine y est connue. Cette
zone paraît être extérieure à
l'agglomération antique.
Zone
G
:
Faisant face à la zone F,
cette dernière zone, qui borde la
chaussée sur son côté septentrional,
s'étend des limites de la commune
d'Estinnes à l'Ouest jusqu'au rond-point
de Vodgoriacum et à la route
Mons-Binche (N.90) à l'Est.

Tombe à incinération
Cette zone semble être
extérieure à l'agglomération antique,
comme le laisse supposer la présence de
tombes. C'est dans cette partie du
territoire de Waudrez qu'ont été
découverts, en 1984, les vestiges d'une
antique nécropole.
Lors de la construction
d'une villa, le CAW, sous la
responsabilité scientifique de Philippe
DEKEGEL, y pratiqua le rapide sauvetage
de huit tombes.
Situées sous le niveau de
culture, ces tombes étaient très bien
conservées. Elles comportaient chacunes
plusieurs vases, dont une urne dans
laquelle étaient déposés les ossements
brûlés. Les urnes avaient été couvertes
par des récipients divers, afin d'en
protéger le contenu. Chaque tombe était
placée dans une fosse quadrangulaire
creusée à même le sol. Les parois
étaient parfois délimitées par des
tuiles. Les pièces de monnaies, les
fibules et certaines céramiques feraient
replacer ces sépultures dans la seconde
moitié du IIème siècle.
En 1994, lors de la
construction d'une villa sur un terrain
voisin, les Services archéologiques de
la Région wallonne procédèrent également
à la fouille d'une série de tombes.
(« Vie
Archéologique » - puits et nécropole de
Vodgoriacum, 3 études- Bulletin de la
Fédération des Archéologues de Wallonie
- n°60 - 2003)
Les
publications
GOOVAERTS, Rvd Père S. ;
« Un
village inconnu…Waudrez, l'ancien
Vodgoriacum des Romains »,
Binche, 1933.
Cet ouvrage de 342 pages
retrace l'histoire de Waudrez depuis la
conquête césarienne jusqu'après la
première guerre mondiale. Il comporte
également un large opuscule relatif à la
seigneurie de Bruille et à ses
occupants, du Moyen Age au début du XXème
siècle.
Prix : 20,00 €
MASSART, Cl. et DEKEGEL,
Ph. ; « Trouvailles
anciennes provenant du vicus de Waudrez
(collection de Gennaro) »,
Waudrez, 1983.
Cette étude de 44 pages
(+ 19 planches d'illustrations) porte
sur le matériel archéologique découvert
par Dominique de
Gennaro
lors de ses recherches sur le site
antique du vicus, et plus
particulièrement d'une cave à parois en
bois, qu'il avait baptisée "fosse
Gallien". L'ensemble du matériel
archéologique conservé fut confié après
son décès au Musée gallo-romain de
Waudrez.
Prix : 8,75 €
STATIO ROMANA, ASBL,
« 25 années d'activités »,
Waudrez, 1994.
Cette brochure, catalogue
d'une exposition temporaire, retrace en
une vingtaine de pages l'histoire et
l’évolution de l’association, de sa
création en 1969 jusque 1994, ainsi que
les activités et fouilles archéologiques
menées par l'ASBL.
Prix : 2,50 €
STATIO ROMANA, ASBL,
« La chaussée romaine »,
Waudrez, 1995.
Ce catalogue broché de 34
pages présente brièvement les chaussées
romaines, en expliquant leur
construction, leur raison d'être ou en
décrivant leurs abords. Il constitue un
guide détaillé pour la préparation d'une
visite du Centre d'interprétation de la
chaussée romaine.
Prix : 7,50 €
« Vie Archéologique»,
Bulletin de la FA.W., n° 60, 2003.
Ce volume de 152 pages
est entièrement consacré aux résultats
de trois études sur une partie du
matériel découvert lors des fouilles
archéologiques de 1983 à 1985 sur le
site de Vodgoriacum : le puits et une
partie de la nécropole.
Prix : 17,00 €
CAPERS, P. et CLAEYS, C.
« La
Citoyenneté en Belgique romaine »,
Waudrez, 2006.
Ce catalogue de
l’exposition temporaire comprend 18
pages. Il explicite la notion de
citoyenneté romaine, son origine, son
évolution dans nos régions et à Rome
ainsi que des droits qui s’y rapportent.
Prix : 5,00 €
CAPERS, P. et CLAEYS, C.
« La
Mode à Rome »,
Waudrez, 2007.
Ce catalogue de
l’exposition temporaire comprend 33
pages. Il est consacré à l’évolution de
l’habillement civil masculin et féminin,
de la parure, de la coiffure, … dans le
monde romain du Ier siècle
avant J.-C. au IVème siècle
après J.-C.
Prix : 6,00 €
Remarque :
En cas d'envoi postal, les frais de port
sont à la charge du destinataire.
P. et C. CAPERS-CLAEYS.
« Mosaïques d’un Empire »,
Waudrez, 2009.
Ce catalogue
de l’exposition temporaire comprend 41
pages. Il présente notamment les
techniques de mise en œuvre, les divers
thèmes et décors, etc… et l’évolution de
l’art de la mosaïque dans l’Empire
Romain.
Prix : 6,00 €
CAPERS, P. et DEKEGEL,
Ph. ; « Vodgoriacum,
le vicus gallo-romain de Waudrez »
(Guide du site, du musée et du centre
d'interprétation de la chaussée romaine),
Waudrez, 2010.
Ce guide de 56 pages est
illustré par de nombreuses
photographies. Il présente brièvement
l'histoire du site gallo-romain de
Vodgoriacum, de son identification
par les modernes et des fouilles qui y
ont été menées. La deuxième partie est
consacrée aux collections visibles au
Musée gallo-romain. Enfin, un chapitre
retrace les différents aspects des
chaussées romaines, qui sont abordés
dans le Centre d'interprétation qui leur
est consacré.
Ce guide, actuellement épuisé, est en cours de révision.
P. et C. CAPERS-CLAEYS.
« Les animaux domestiques dans
le monde romain »,
Waudrez, 2010.
Construite sur base des textes latin,
des découvertes iconographiques,
romaines et des vestiges archéologiques
(à Waudrez - Vodgoriacum - notamment),
cette exposition retrace les rapports
que les hommes ont entretenus avec les
animaux domestiques ou familiers dans
l'Antiquité romaine.
« Deux intailles découvertes sur le site de Vodgoriacum (Waudrez) » de Pierre-Benoît GERARD, Waudrez, 2014.
Lors
de la fouille d’une cave d’habitation, de 1985 à 1988, sur le site
gallo-romain de Vodgoriacum, deux intailles en cornaline ont été
découvertes.
Elles
sont complètement intactes et ne présentent aucun éclat. Les bagues,
dans lesquelles elles étaient enchâssées, n’ont pas été retrouvées.
Ces intailles sont exposées au Musée Gallo-Romain de Waudrez.
Cette monographie est une étude approfondie et détaillée de ces deux intailles.
Prix : 10 €
Le musée gallo-romain
HISTORIQUE DU
musee gallo-romain
Un des objectifs de l’ASBL
STATIO ROMANA (ex Cercle Archéologique
de Waudrez), qui gère le Musée
Gallo-Romain, consiste en la mise en
valeur de notre patrimoine archéologique
régional : le vicus gallo-romain
de Vodgoriacum.
Les activités de
l’association ne sont pas seulement
destinées à prendre connaissance de
notre patrimoine mais aussi à tout
mettre en œuvre pour le protéger et à
sensibiliser le public.
Ainsi, afin d’assurer une
mise en valeur sérieuse du patrimoine,
un petit musée provisoire, situé rue de
Clerfayt à Waudrez, était inauguré, dès
mai 1980, par Philippe DEKEGEL, le
Conservateur.
Ce premier musée
présentait les quelques découvertes
réalisées par feu Dominique de GENNARO,
ainsi que le premières découvertes de
l’association qui pratiquait la fouille
systématique du vicus depuis
1978.

Rue de Clerfayt à Waudrez
En 1980, Léon DURANT fait
donation à l’association de sa fermette
du XIXème siècle – composée
de plusieurs bâtiments dans un état de
délabrement assez avancé – mais
idéalement situé en plein cœur du
vicus de Vodgoriacum.
Progressivement et très
lentement (en fonction des moyens
financiers et de l’importance des
travaux à réaliser), l’ASBL entreprend
la restauration d’une première partie
des bâtiments.
14, Chaussée Romaine à Waudrez
C’est en 1987, le 9 mai,
qu’a lieu l’ouverture officielle du
Musée Gallo-Romain, idéalement installé
au cœur même du vicus de
Vodgoriacum, le long de la chaussée
romaine menant de Bavay à Cologne.
Les nombreuses
découvertes du site sont ainsi exposées
dans une première salle de Musée.


9 mai 1987 : Inauguration du Musée
En 1990, suite au décès
de son généreux donateur, l’ASBL STATIO
ROMANA devient propriétaire de
l’entièreté des bâtiments.
Dès lors, aidée de ses
Membres et de bénévoles, elle entreprend
progressivement l’extension et le nouvel
aménagement du Musée.
Le Musée est conçu aussi
bien pour l’accueil de groupes scolaires
ou divers que de particuliers. Il est
installé de plain-pied, notamment pour
faciliter l’accès aux handicapés et aux
personnes âgées.
De 2002 à 2010, Pierre CAPERS assure le
poste de conservateur du musée.
En 2010, Philippe DEKEGEL redevient le
conservateur du musée gallo-romain de
Waudrez.

Le Musée – vue d’ensemble -
Aujourd’hui, le visiteur
commence sa visite par la salle
d’accueil et de présentation du site,
suivie par les deux salles de Musée et
l’exposition temporaire.
La visite se poursuit par
le Centre d’Interprétation de la
Chaussée Romaine qui présente une
exposition permanente consacrée
essentiellement à « La Chaussée
Romaine ».
Lors des visites guidées,
le visiteur peut également découvrir le
laboratoire de céramologie, installé au
premier étage.
Il peut aussi assister,
dans la salle de projection, à un
reportage audio-visuel de quarante
minutes qui présente le vicus,
les fouilles anciennes aujourd’hui
rebouchées, les découvertes réalisées et
les activités de l’association.

Visite guidée
VISITE
DU
musee gallo-romain
Situé au cœur même de
l'antique agglomération, le Musée tente
de faire mieux connaître la civilisation
romaine dans l'antique province de la
Gallia Belgica et plus
particulièrement dans la cité des
Nerviens.
L'ensemble des objets
présentés, hormis le matériel
néolithique du site minier de Spiennes,
ont été exhumés du site de
Vodgoriacum.
De multiples aspects de
la vie quotidienne sont abordés au
travers de vitrines thématiques exposant
objets, dessins, explications, … le
Musée se voulant didactique.
 |
 |
 |
|
Fragment de dolium |
Four de bronzier |
Tour de potier |
Une première vitrine
retrace l'historique des recherches à
Vodgoriacum ; d’autres exposent les
vestiges matériels caractéristiques de
la vie quotidienne dans nos régions, du
début du Ier siècle de notre
ère jusqu'aux années 260 de notre ère.
Céramiques
de luxe ou d'usage courant, fruits d'importations lointaines ou de
productions régionales, constituent bien sûr la base des
collections.
Mais il est également
possible d'y voir les traces de faune
domestique et sauvage, des petits objets
usuels de la vie courante ou encore les
antiques matériaux de construction.
Parmi les pièces
céramiques remarquables, nous
mentionnerons pour mémoire un alphabet
latin gravé sur céramique, plusieurs
gobelets métallescents à dépressions,
plusieurs assiettes en rouge pompéien,
une belle collection de céramique
sigillée, plusieurs vases en terra
nigra, une importante batterie de
cuisine en commune sombre, un seau de
Bavay ou encore un jeton gravé imitant
une monnaie.

Céramique sigillée
Une partie de toiture
romaine ainsi qu’une tombe à
incinération ont été reconstituées à
l’intérieur du Musée.
 |
 |
|
Toiture romaine |
Tombe T8 |
On pourra également y
découvrir deux très belles intailles en
cornaline ou encore plusieurs poignées
de coffrets en bronze, ainsi que de
multiples fibules, des plus frustes aux
plus ornementées, etc…
Sans oublier, last
but not least, le KIK, petit
personnage gravé sur un moellon calcaire
qui vous salue du haut de ses ...presque
2000 ans !

« KIK »
Le Centre
d’Interprétation de
la Chaussée Romaine
BOULOGNE-BAVAY-TONGEREN-KÖLN
« Le Centre
d’Interprétation » est un milieu
privilégié, un milieu thématisé, un
milieu d’animation intégré, où sont
rassemblés en système plusieurs moyens
d’interprétation permettant et
favorisant la communication directe
individu-patrimoine et la participation
collective à la conservation et à la
mise en valeur de ce milieu et de
l’environnement en général.
La Chaussée Romaine,
celle que nous croisons depuis notre
plus tendre enfance, méritait bien qu’un
jour on lui accorde la meilleure
attention dans le contexte d’un « Centre
d’Interprétation ».
Son histoire, c’est celle
de nos villes et nos villages qui la
côtoient, c’est l’histoire d’une région,
c’est l’histoire d’un pays.
Responsable du premier
grand défrichement privilégiant et
organisant le « déplacement », elle
reste à la base des grands échanges
commerciaux, l’embryon de l’essor
économique aujourd’hui possible grâce à
nos nombreux moyens de communication.
Une première exposition
présente, en fait, la « table des
matières » des grands thèmes qui seront
développés, plus largement, dans le
Centre d’Interprétation de la Chaussée
Romaine.
Un catalogue complète
l’exposition.
Contact : voir :
www.viaromana.org
Retour à l'accueil
Haut de page
Site optimisé 1440 x
900
© Statioromana.org - Philippe Dekegel, 2008
- 2010.
Tous droits réservés. Toute
reproduction, partielle ou complète,
interdite.
Pour tout
problème sur le site, question ou
commentaire, contactez
Philippe
Dekegel |